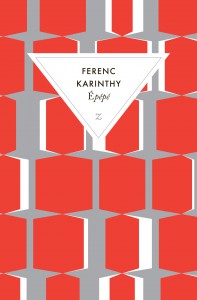
Après Un temps de saison de Marie Ndiaye, c’est au tour de Epépé de Ferenc Karinthy de nous plonger au cœur du bizarre. Ces deux romans ont ceci de commun qu’ils transportent leur personnage principal dans un monde qui devrait être familier mais qui s’avère inquiétant, menaçant, et tout à fait autre : les codes échappent complètement aux héros qui, ne maîtrisant plus rien, doivent décupler des forces inouïes pour créer du sens, s’adapter à leur nouvel environnement, s’en extirper et retrouver l’univers qu’ils ont quitté.
Epépé relate l’histoire de Budaï, un linguiste de renom qui, alors qu’il devait se rendre à Helsinki pour un congrès, se retrouve dans une ville inconnue dont ses habitants parlent une langue qu’il n’a jamais entendue. Il s’est endormi dans l’avion qui devait le mener au congrès et l’appareil a atterri dans une ville étrange, immense, surpeuplée, grouillante de vie et de mystères.
Epépé a été publié en 1970. Son auteur hongrois, Ferenc Karinthy (1921-1992), est relativement peu connu en France. Seules trois de ses œuvres ont été traduites en français, dont Epépé, qui a permis à l’auteur de se faire joliment remarquer. J’avais repéré ce titre quand je travaillais en librairie. Il était alors édité par Denoël, dans la collection « Denoël & d’ailleurs » (en 1999 et 2005). Puis, c’est Zulma qui l’a repris en 2013. Il faisait figure de livre étrange, inclassable, et ses aficionados, quand ils en parlaient, avaient de drôles de lueurs dans les yeux. Ce n’est qu’aujourd’hui que je le lis et je tiens à m’excuser auprès des personnes qui me l’avaient chaudement recommandé. C’est un livre que j’ai trouvé effectivement marquant, singulier, par moment hallucinant, et éprouvant ( ! ) Je ne cache pas que j’en ai trouvé la lecture quelquefois difficile car il n’y a aucun temps mort, aucune pause : le héros, se heurtant à un monde qu’il ne comprend absolument pas, cherche sans s’interrompre des clés (il faut dire que c’est une question de survie ! ) Il observe, il analyse, il creuse, sans faiblir, il cherche encore et encore et nous fait participer à sa quête du sens. Un livre donc qui se « mérite » mais quel plaisir de se laisser plonger dans l’inconnu, l’insaisissable !
L’inconnu, nous y sommes confrontés dès le début du livre lorsque Budaï se réveille dans l’avion qui vient de se poser. Il est emporté d’emblée par un mouvement qu’il ne contrôle pas. Les passagers descendent de l’appareil, il est entraîné par la foule, englouti dans l’agitation de l’aéroport, prend le bus que tout le monde prend pour se rendre au centre-ville et se retrouve dans un hôtel face à un réceptionniste qui le presse de se faire enregistrer. Mais quelle est la langue que celui-ci parle ? Budaï n’en sait fichtrement rien, il a beau chercher de l’aide autour de lui, personne ne le comprend et il ne comprend personne :
(…) il a beau poser et répéter ses questions dans toutes les langues qu’il connaît, aller jusqu’à crier le mot « information », on lui répond chaque fois de cette même manière incompréhensible, sur cette intonation inarticulée, craquelante : ébébé ou pépépé, étyétyé ou quelque chose comme ça ; ses oreilles raffinées et habituées à capter les consonances les plus variées et à distinguer les nuances, n’entendent pourtant cette fois que des grognements et des croassements.
Il a le tournis. Et la foule emplit le hall de l’hôtel, déborde sur le trottoir. Pourquoi y-a-t-il autant de monde ? La foule est partout, les gens s’affairent, pressés, font peu cas de lui, le bousculent. Il est plongé au cœur d’une masse, incompréhensible :
Le hall ne désemplit toujours pas, Budaï est bousculé, comprimé, il doit se frayer un chemin jusqu’au tourniquet de sortie (…) Dans la rue la cohue n’a pas diminué non plus, la multitude tangue, oscille dans tous les sens formant des courants et des tourbillons. Tout le monde est pressé, halète, joue des coudes dans la masse ; une petite vieille, un foulard sur la tête, pétarade à côté de lui en lui donnant un coup de pied dans la cheville et accessoirement quelques coups de coude dans les côtes. Sur la chaussée, les véhicules se suivent de près en essaims tout aussi denses, s’agglomèrent et redémarrent sans laisser nulle part une chance aux piétons de traverser, formant constamment des bouchons en un incessant fracas de moteurs et de klaxons(…)
Il parvient cependant à se faire remettre une clé de chambre par le guichetier de l’hôtel qui lui substitue au passage son passeport, le privant ainsi de son identité ! Un départ narratif donc sur les chapeaux de roues. Et le rythme ne faiblira pas jusqu’à la dernière page. Les situations problématiques s’accumulent, malmenant de plus en plus Budaï. L’écriture serrée, sans temps mort, ne nous laisse pas respirer. Il y a notamment peu de blancs typographiques : peu de découpages en chapitres et les paragraphes sont longs et touffus. Budaï et le lecteur seront ballottés de page en page, bousculés et happés par le bruit, l’agitation constante. Les seules pauses ménagées seront les moments de réflexion de Budaï quand il se retrouve seul dans sa chambre, au calme, et tente de déchiffrer, avec analyse et force concentration, cette langue si étrange. Enfin, « pauses » est un bien grand mot car Budaï, en bon étymologiste qu’il est, puise dans toutes ses facultés intellectuelles, éprouve toutes ses méthodes de déchiffrage, épuise toute la vivacité de son esprit et se heurte, encore et encore, au caractère indéchiffrable de cette langue et de son écriture.
Une bonne âme heureusement lui apportera un peu de réconfort. La liftière de l’hôtel en effet n’est pas insensible à son charme et partagera avec lui des moments de sensualité et d’apaisement. Dédé, Edédé, Tété ou Bébé (il ne saisit pas bien son prénom, les sonorités de cette fichue langue ne cessent de lui échapper) sera la seule personne avec laquelle il pourra communiquer. Cela sera par contre au-delà des mots, seules compteront l’intonation et la douceur des corps. Il la perdra malheureusement de vue, tous deux happés par l’agitation de la ville.
Budaï est cependant combatif, et n’aura de cesse, tout au long du roman, de chercher à quitter la ville, à la fuir, à défaut d’en comprendre ses habitants. Mais la ville est mouvante, tentaculaire, semble n’avoir pas de fin. Budaï n’arrive pas à atteindre la périphérie. Toujours des voitures, du monde, même dans des endroits tels que les cimetières, les églises, les abattoirs ( ! ) Un défilé permanent, harassant, hallucinant. Mais Budaï ne renonce pas :
(…) il s’engage à rester dans la ville encore une année ou deux, voire même cinq ou dix, à condition d’avoir la certitude de pouvoir entrer chez lui ensuite. A condition d’avoir la possibilité de compter à rebours les jours, les semaines, les mois qui restent.
Ou alors, n’y aura-t-il pas de retour ? Est-ce ici sa dernière station, l’ultima Thulé des antiques où il devait échouer, quelle qu’ait été sa destination, Helsinki ou toute autre, et où tôt ou tard tous les hommes échouent ?
Epépé, ou le cauchemar éveillé d’un homme qui, en dépit de ce qu’il est, et de ce qu’il avait, se heurte à l’échec, l’incommunicabilité, peut-être même à l’insoluble. Le mauvais sort, l’arbitraire, ont bouleversé sa vie. Il est plongé constamment dans l’inconnu et la solitude. C’est terrible, profondément absurde. Cela m’a fait froid dans le dos.
Edité par Zulma en 2013, collection Poche.
Traduit du hongrois par Judith et Pierre Karinthy

Belle présentation… Merci !
J’aimeAimé par 1 personne
Merci Goran ! Il faut dire que c’est un livre extraordinaire, j’ai voulu m’ appliquer 😊
J’aimeAimé par 1 personne
Ah encore une pépite de chez Zulma.
J’aimeAimé par 1 personne
Oui! Avec leur catalogue, j’ai une pile de livres à lire haute comme un immeuble…
J’aimeAimé par 1 personne
Cela doit en mettre plein la vue côté couleurs. 🙂
J’aimeJ’aime